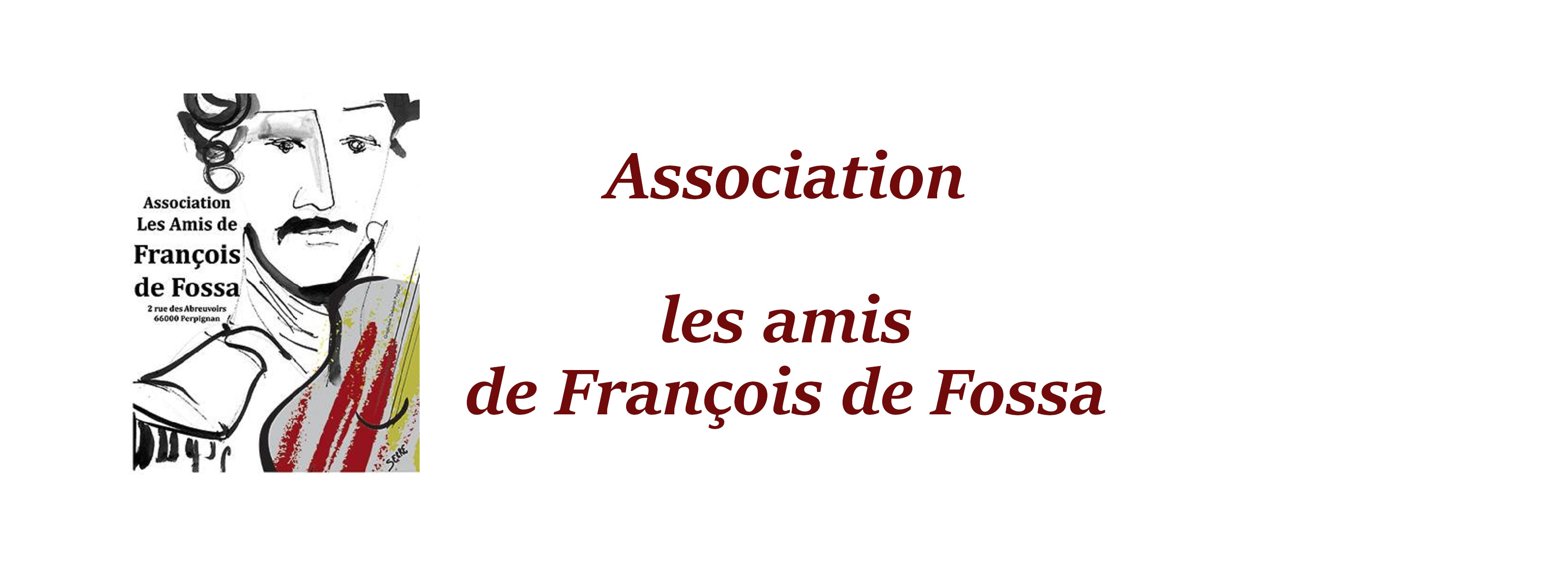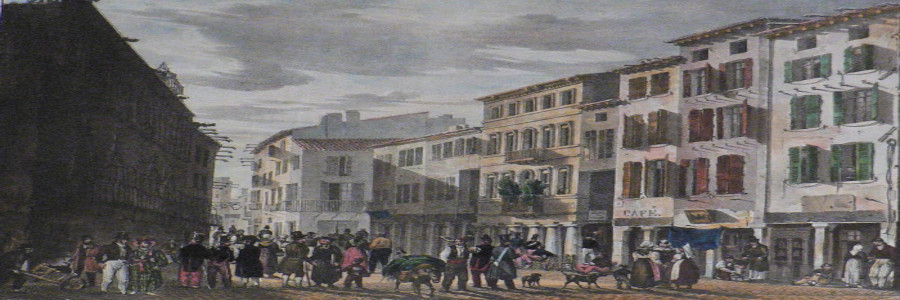François de Fossa en Bordelais
Venant de Moulins dans l’Allier, sa première affectation au service du roi de
France, le capitaine de Fossa s’est ensuite retrouvé en garnison à Bordeaux, où il arrive
début septembre 1816, à la tête d’une compagnie. Il restera en Bordelais jusqu’en
octobre 1817 et de là, il rejoindra Perpignan pour y passer son semestre de repos.
Quelques jours après son arrivée, il est envoyé au fort de Blaye à sept lieues de
Bordeaux ; accueilli par le commandant de la citadelle, qu’il trouve charmant, il s’y plaira
beaucoup. Son logement chez madame Peyrotte est agréable, il donne sur le quaipromenade qui longe l’estuaire de la Garonne. En revanche, les nombreuses allées et
venues pour raisons de service entre le fort de Blaye et la caserne de Bordeaux lui
pèseront toujours.
Durant ses loisirs à Blaye, il fréquente les salons de madame Blay et madame de
Marguerit qui ont de la famille à Perpignan et ont bien connu Thérèse, sa sœur, mariée à
Joseph Campagne. Leurs salons sont connus et on y apprécie la musique. À Bordeaux,
on a chargé le capitaine de Fossa d’organiser la musique du régiment et il écrit des
arrangements pour les musiciens, dont malheureusement la trace n’a pas été retrouvée.
Il trouve la ville belle mais il s’y ennuie. Non loin du Grand Théâtre, il fréquente la
boutique d’un facteur d’instruments de musique qui vend aussi des partitions, François
Parisot. Il fait la connaissance de Pierre Galin, un mathématicien qui a ecrit une méthode
d’enseignement de la musique qui séduira François de Fossa, au point qu’il la citera à
plusieurs reprises dans les années qui suivent. Ensemble, ils assistent à des concerts
dans le prestigieux Grand Théâtre de la ville, à l’acoustique remarquable.
De retour de la Campagne des Cent Mille Fils de Saint-Louis en Espagne,
François de Fossa repassera brièvement par Bordeaux en janvier 1825, et rendra visite
à son ancien protecteur en exil, Miguel José de Azanza, qui fut vice-roi du Mexique : il
habite avec sa femme rue des Carmélites, dans une petite maison, où il terminera ses
jours. Depuis un an, le peintre Goya vit aussi à Bordeaux, sur le cours de Tourny, mais
François de Fossa n’aura pas l’occasion de le rencontrer. Il est en route pour la garnison
de Tours.
Nicole Yrle
France, le capitaine de Fossa s’est ensuite retrouvé en garnison à Bordeaux, où il arrive
début septembre 1816, à la tête d’une compagnie. Il restera en Bordelais jusqu’en
octobre 1817 et de là, il rejoindra Perpignan pour y passer son semestre de repos.
Quelques jours après son arrivée, il est envoyé au fort de Blaye à sept lieues de
Bordeaux ; accueilli par le commandant de la citadelle, qu’il trouve charmant, il s’y plaira
beaucoup. Son logement chez madame Peyrotte est agréable, il donne sur le quaipromenade qui longe l’estuaire de la Garonne. En revanche, les nombreuses allées et
venues pour raisons de service entre le fort de Blaye et la caserne de Bordeaux lui
pèseront toujours.
Durant ses loisirs à Blaye, il fréquente les salons de madame Blay et madame de
Marguerit qui ont de la famille à Perpignan et ont bien connu Thérèse, sa sœur, mariée à
Joseph Campagne. Leurs salons sont connus et on y apprécie la musique. À Bordeaux,
on a chargé le capitaine de Fossa d’organiser la musique du régiment et il écrit des
arrangements pour les musiciens, dont malheureusement la trace n’a pas été retrouvée.
Il trouve la ville belle mais il s’y ennuie. Non loin du Grand Théâtre, il fréquente la
boutique d’un facteur d’instruments de musique qui vend aussi des partitions, François
Parisot. Il fait la connaissance de Pierre Galin, un mathématicien qui a ecrit une méthode
d’enseignement de la musique qui séduira François de Fossa, au point qu’il la citera à
plusieurs reprises dans les années qui suivent. Ensemble, ils assistent à des concerts
dans le prestigieux Grand Théâtre de la ville, à l’acoustique remarquable.
De retour de la Campagne des Cent Mille Fils de Saint-Louis en Espagne,
François de Fossa repassera brièvement par Bordeaux en janvier 1825, et rendra visite
à son ancien protecteur en exil, Miguel José de Azanza, qui fut vice-roi du Mexique : il
habite avec sa femme rue des Carmélites, dans une petite maison, où il terminera ses
jours. Depuis un an, le peintre Goya vit aussi à Bordeaux, sur le cours de Tourny, mais
François de Fossa n’aura pas l’occasion de le rencontrer. Il est en route pour la garnison
de Tours.
Nicole Yrle
Thérèse de Fossa (1767-1823), une femme mystérieuse…
Par Nicole Yrle
À notre connaissance, il n’existe aucun portrait de Thérèse, la sœur tant aimée de François de Fossa. Celui que possédait son frère, et qu’il évoque dans sa correspondance, a disparu... Elle aura à jamais le visage que chacun de nous lui donne et gardera donc son mystère.
Elle fut pour notre musicien bien plus qu’une sœur aînée... une marraine, une amie, une confidente, une conseillère, une correspondante privilégiée, et surtout elle représenta la femme idéale, celle qu’il chercha, des années durant, à retrouver à travers toutes celles qu’il courtisait, jusqu’à ce qu’il rencontrât Sophie, celle qui devint son épouse. Notons au passage que Thérèse était morte d’un cancer depuis près de trois ans quand le mariage eut lieu… Il n’écrira jamais plus à sa sœur chérie, qu’il appelait « Ma chère amie » puis « Ma bonne amie » dans toutes ses lettres...
À n’en pas douter, Thérèse était une femme de caractère, très pieuse et musicienne, qui vouait une affection sans bornes à son frère. On l’imagine séduisante et intelligente. Elle fut manifestement une épouse et mère modèle. Son mari, Joseph Campagne, lui survécut dix-sept ans et jamais ne la remplaça.
Comment se fait-il qu’aucune des partitions de FRANÇOIS parvenues jusqu’à nous ne lui soit dédiée ? Un autre mystère, car, nous le savons, elle aussi avait appris la guitare : «[...] ta fille s’exerce à la guitare pour te régaler », écrivait leur mère à son mari, alors à Paris, en août 1785. Plus tard, c’est avec une de ses guitares que sa fille Thérésette apprendra les premiers rudiments de cet instrument… À moins qu’un jour ne réapparaisse, après avoir dormi dans un tiroir, un grenier, ou au milieu d’un monceau de partitions oubliées, celle que son frère composa pour elle, en pensant à elle ?
Nous devons beaucoup à Thérèse de Fossa, devenue Mme Campagne, puisque ce sont les 572 lettres que François de Fossa lui adressa en 27 ans qui constituent la principale source de ce que nous savons de lui. En revanche, nous ne possédons qu’une seule lettre-réponse de sa main, datée du 8 septembre 1820, dans laquelle elle lui enjoint de venir passer son congé d’officier à Perpignan : « […] je ne veux point être privée de t’avoir six mois auprès de moi, peut-être sera-ce la dernière fois que nous nous réunirons, ainsi point de raison, tu passeras les six mois ou je ne t’aimerais plus de ma vie de vouloir ainsi m’affliger. »
On vous le disait, une femme de caractère !
Nicole Yrle
Elle fut pour notre musicien bien plus qu’une sœur aînée... une marraine, une amie, une confidente, une conseillère, une correspondante privilégiée, et surtout elle représenta la femme idéale, celle qu’il chercha, des années durant, à retrouver à travers toutes celles qu’il courtisait, jusqu’à ce qu’il rencontrât Sophie, celle qui devint son épouse. Notons au passage que Thérèse était morte d’un cancer depuis près de trois ans quand le mariage eut lieu… Il n’écrira jamais plus à sa sœur chérie, qu’il appelait « Ma chère amie » puis « Ma bonne amie » dans toutes ses lettres...
À n’en pas douter, Thérèse était une femme de caractère, très pieuse et musicienne, qui vouait une affection sans bornes à son frère. On l’imagine séduisante et intelligente. Elle fut manifestement une épouse et mère modèle. Son mari, Joseph Campagne, lui survécut dix-sept ans et jamais ne la remplaça.
Comment se fait-il qu’aucune des partitions de FRANÇOIS parvenues jusqu’à nous ne lui soit dédiée ? Un autre mystère, car, nous le savons, elle aussi avait appris la guitare : «[...] ta fille s’exerce à la guitare pour te régaler », écrivait leur mère à son mari, alors à Paris, en août 1785. Plus tard, c’est avec une de ses guitares que sa fille Thérésette apprendra les premiers rudiments de cet instrument… À moins qu’un jour ne réapparaisse, après avoir dormi dans un tiroir, un grenier, ou au milieu d’un monceau de partitions oubliées, celle que son frère composa pour elle, en pensant à elle ?
Nous devons beaucoup à Thérèse de Fossa, devenue Mme Campagne, puisque ce sont les 572 lettres que François de Fossa lui adressa en 27 ans qui constituent la principale source de ce que nous savons de lui. En revanche, nous ne possédons qu’une seule lettre-réponse de sa main, datée du 8 septembre 1820, dans laquelle elle lui enjoint de venir passer son congé d’officier à Perpignan : « […] je ne veux point être privée de t’avoir six mois auprès de moi, peut-être sera-ce la dernière fois que nous nous réunirons, ainsi point de raison, tu passeras les six mois ou je ne t’aimerais plus de ma vie de vouloir ainsi m’affliger. »
On vous le disait, une femme de caractère !
Nicole Yrle
Qui était Sophie, l’épouse de François de Fossa ?
Lorsque le chef de bataillon, Chevalier de Saint-Louis, François de Fossa se maria, il avait déjà vécu un demi-siècle. Sa fiancée avait vingt-trois ans de moins que lui. Le mariage eut lieu à Strasbourg, le 29 décembre 1825. Trois ans plus tôt, le musicien avait eu la douleur de perdre sa sœur Thérèse. Aucune des femmes rencontrées jusque-là n’arrivait à la cheville de celle qu’il chérissait depuis l’enfance. Mais Sophie, manifestement, avait toutes les qualités requises et elle apporta le bonheur à François, lui que les épreuves n’avaient pas épargné depuis sa jeunesse.
Née le 18 Floréal an VI (7 mai 1798), la jeune épousée était la fille de feu Mansuy Vautrin, fabricant de chandelles installé à proximité de la cathédrale. Ce dernier était issu d’une famille lorraine de boulangers, catholique de génération en génération. Engagé volontaire dans le 9e bataillon de l’Ain révolutionnaire, Mansuy avait été élu officier par les soldats-citoyens ; envoyé à Strasbourg, le lieutenant des grenadiers y rencontra Marguerite, sa future femme, âgée de seize ans. Il quitta l’armée et l’épousa. La toute jeune femme, très vite mère d’un garçon, appartenait à une famille de riches blanchisseurs protestants, les Schwing. Sophie naquit deux ans plus tard et à quinze ans, elle perdit son père, mort prématurément d’une probable maladie professionnelle.
Mystérieuse Sophie… Nous n’avons d’elle aucun portrait et en sommes réduits à l’imaginer. Elle reçut certainement une éducation soignée. François de Fossa lui dédia, avant leur mariage, l’arrangement d’une sérénade de Beethoven et l’ouverture de l’opéra Le Calife de Bagdad de Boieldieu, ce qui prouve qu’elle jouait de la guitare, et certainement fort bien, car les pièces en question ne sont pas faciles. Plus tard, Dionisio Aguado composa pour l’épouse de son ami de Fossa Six petites pièces, techniquement complexes. Peut-être ressemblait-elle à la jeune femme qui posa pour le peintre Descours ?
L’alliance François de Fossa/Sophie Vautrin a de quoi surprendre et il n’est pas certain que Thérèse, en bonne descendante d’une famille catalane anoblie, catholique et monarchiste, l’aurait approuvée ! D’ailleurs l’armée à qui François de Fossa a dû demander l’autorisation de se marier, ne l’a pas accordée du premier coup ! Il fallut l’intervention d’un personnage haut placé, M. de Sainte-Suzanne, sans oublier que la tante de Sophie était la veuve de Jean Legrand, lieutenant-colonel, ancien commandant de la place de Belfort, couvert d’honneurs. En tout cas, François, qui avait vécu des changements considérables, jetait sans doute sur le monde un regard distancié et il a su apprécier en Sophie ce qui ferait d’elle l’épouse dont il rêvait.
Le couple connut un bonheur sans nuages, en témoigne ce très joli passage d’une lettre adressée par François à son neveu en 1827 : « Depuis que j’existe, je n'ai jamais goûté une telle somme de bonheur. Tu ne le comprendras que lorsque tu auras toi-même uni ton sort à une femme qui partage tous tes goûts, toutes tes idées, car ce n'est que de cette manière qu'on est réellement duo in carne una ». Trois enfants naquirent, Victor (1826), Cécile (1827) et Laurent (1832). Le premier est né à Paris, la seconde à Besançon et le troisième à Romans : il est clair que Sophie a suivi son époux de garnison en garnison, ce qui n’était guère fréquent à une époque où les militaires changeaient d’affectation presque chaque année.
Autre fait notoire, l’aide efficace que Sophie apporta à son mari à la suite de la délicate affaire survenue à Salon dans la nuit du 28 au 29 juillet en 1839 : une altercation entre des soldats de son régiment et des bourgeois tourne mal, le capitaine d’astreinte cette nuit-là fait preuve de précipitation, agit sans réquisition de l’autorité civile et ne prévient le Major de Fossa que quand tout est fini avec un mort et plusieurs blessés, civils et militaires, à déplorer. De Fossa, après enquête, sanctionne des soldats et des officiers coupables de manquements graves. Mais il est désavoué par le Général et doit se défendre ! Là-dessus, il s’absente pour accompagner ses enfants, Cécile et Victor, futurs élèves à St Denis et à La Flèche. En son absence, une véritable cabale est montée contre lui au sein du régiment : on lui en veut de n’avoir pas fermé les yeux sur les exactions de camarades de corps et d’avoir pris le parti des bourgeois ! Sophie reçoit des instructions précises de son mari et s’en acquitte à merveille, portant une lettre au juge pour demander une enquête ciblée avec des témoins désignés qu’elle va voir un à un pour qu’ils disent « toute la vérité, rien que la vérité ». Seule une femme amoureuse, convaincue et intelligente comme l’était Sophie, a pu mener à bien pareilles actions. Avec son aide, François de Fossa s’en est tiré avec les honneurs et sans doute une grande amertume.
La carrière militaire du Major de Fossa s’acheva à Paris et c’est là qu’il mourut en 1849, laissant une veuve de cinquante et un ans et un fils de dix-sept ans. L’aîné, Victor était sous-officier en Guadeloupe, il mourut cinq ans après son père. Malgré l’opposition de sa mère, Cécile entra dans les ordres et mourut en 1868 au couvent de Bordeaux. Laurent, le petit dernier, embrassa lui aussi la carrière militaire mais c’était un joueur invétéré qui eut maille à partir avec la justice et dut démissionner de l’armée. Il est probable que son comportement donna bien des soucis à sa mère. Finit-il par s’assagir ? Peut-être… Il se maria et Sophie devint grand-mère.
Elle vécut jusqu’à l’âge de quatre-vingt quatre ans et s’éteignit à Paris en 1889. Elle dort son dernier sommeil aux côtés de son mari, au cimetière du Montparnasse.
Nicole YRLE
Née le 18 Floréal an VI (7 mai 1798), la jeune épousée était la fille de feu Mansuy Vautrin, fabricant de chandelles installé à proximité de la cathédrale. Ce dernier était issu d’une famille lorraine de boulangers, catholique de génération en génération. Engagé volontaire dans le 9e bataillon de l’Ain révolutionnaire, Mansuy avait été élu officier par les soldats-citoyens ; envoyé à Strasbourg, le lieutenant des grenadiers y rencontra Marguerite, sa future femme, âgée de seize ans. Il quitta l’armée et l’épousa. La toute jeune femme, très vite mère d’un garçon, appartenait à une famille de riches blanchisseurs protestants, les Schwing. Sophie naquit deux ans plus tard et à quinze ans, elle perdit son père, mort prématurément d’une probable maladie professionnelle.
Mystérieuse Sophie… Nous n’avons d’elle aucun portrait et en sommes réduits à l’imaginer. Elle reçut certainement une éducation soignée. François de Fossa lui dédia, avant leur mariage, l’arrangement d’une sérénade de Beethoven et l’ouverture de l’opéra Le Calife de Bagdad de Boieldieu, ce qui prouve qu’elle jouait de la guitare, et certainement fort bien, car les pièces en question ne sont pas faciles. Plus tard, Dionisio Aguado composa pour l’épouse de son ami de Fossa Six petites pièces, techniquement complexes. Peut-être ressemblait-elle à la jeune femme qui posa pour le peintre Descours ?
L’alliance François de Fossa/Sophie Vautrin a de quoi surprendre et il n’est pas certain que Thérèse, en bonne descendante d’une famille catalane anoblie, catholique et monarchiste, l’aurait approuvée ! D’ailleurs l’armée à qui François de Fossa a dû demander l’autorisation de se marier, ne l’a pas accordée du premier coup ! Il fallut l’intervention d’un personnage haut placé, M. de Sainte-Suzanne, sans oublier que la tante de Sophie était la veuve de Jean Legrand, lieutenant-colonel, ancien commandant de la place de Belfort, couvert d’honneurs. En tout cas, François, qui avait vécu des changements considérables, jetait sans doute sur le monde un regard distancié et il a su apprécier en Sophie ce qui ferait d’elle l’épouse dont il rêvait.
Le couple connut un bonheur sans nuages, en témoigne ce très joli passage d’une lettre adressée par François à son neveu en 1827 : « Depuis que j’existe, je n'ai jamais goûté une telle somme de bonheur. Tu ne le comprendras que lorsque tu auras toi-même uni ton sort à une femme qui partage tous tes goûts, toutes tes idées, car ce n'est que de cette manière qu'on est réellement duo in carne una ». Trois enfants naquirent, Victor (1826), Cécile (1827) et Laurent (1832). Le premier est né à Paris, la seconde à Besançon et le troisième à Romans : il est clair que Sophie a suivi son époux de garnison en garnison, ce qui n’était guère fréquent à une époque où les militaires changeaient d’affectation presque chaque année.
Autre fait notoire, l’aide efficace que Sophie apporta à son mari à la suite de la délicate affaire survenue à Salon dans la nuit du 28 au 29 juillet en 1839 : une altercation entre des soldats de son régiment et des bourgeois tourne mal, le capitaine d’astreinte cette nuit-là fait preuve de précipitation, agit sans réquisition de l’autorité civile et ne prévient le Major de Fossa que quand tout est fini avec un mort et plusieurs blessés, civils et militaires, à déplorer. De Fossa, après enquête, sanctionne des soldats et des officiers coupables de manquements graves. Mais il est désavoué par le Général et doit se défendre ! Là-dessus, il s’absente pour accompagner ses enfants, Cécile et Victor, futurs élèves à St Denis et à La Flèche. En son absence, une véritable cabale est montée contre lui au sein du régiment : on lui en veut de n’avoir pas fermé les yeux sur les exactions de camarades de corps et d’avoir pris le parti des bourgeois ! Sophie reçoit des instructions précises de son mari et s’en acquitte à merveille, portant une lettre au juge pour demander une enquête ciblée avec des témoins désignés qu’elle va voir un à un pour qu’ils disent « toute la vérité, rien que la vérité ». Seule une femme amoureuse, convaincue et intelligente comme l’était Sophie, a pu mener à bien pareilles actions. Avec son aide, François de Fossa s’en est tiré avec les honneurs et sans doute une grande amertume.
La carrière militaire du Major de Fossa s’acheva à Paris et c’est là qu’il mourut en 1849, laissant une veuve de cinquante et un ans et un fils de dix-sept ans. L’aîné, Victor était sous-officier en Guadeloupe, il mourut cinq ans après son père. Malgré l’opposition de sa mère, Cécile entra dans les ordres et mourut en 1868 au couvent de Bordeaux. Laurent, le petit dernier, embrassa lui aussi la carrière militaire mais c’était un joueur invétéré qui eut maille à partir avec la justice et dut démissionner de l’armée. Il est probable que son comportement donna bien des soucis à sa mère. Finit-il par s’assagir ? Peut-être… Il se maria et Sophie devint grand-mère.
Elle vécut jusqu’à l’âge de quatre-vingt quatre ans et s’éteignit à Paris en 1889. Elle dort son dernier sommeil aux côtés de son mari, au cimetière du Montparnasse.
Nicole YRLE
François de Fossa et le muscat de Rivesaltes !
Voici ce qu’on peut lire au début d’une lettre adressée en octobre 1813 depuis Montauban par François de Fossa lui-même à sa sœur Thérèse, épouse de Joseph Campagne, restée dans la demeure familiale à Perpignan :
« [Ma lettre] te trouvera vraisemblablement à Rivesaltes chez notre aimable nièce que tu embrasseras de ma part. Tu me dis dans ta dernière que tu allais y passer quelques jours et je désire que les eaux te soient favorables ainsi qu'à mon pauvre petit filleul que j'apprends avec peine souffrir encore de ses yeux. Quant à moi si j'étais du voyage je vous laisserais à tous deux boire de l'eau dans un pays où c'est un meurtre d'en mettre dans son vin, et je tâcherais d'oublier à l'aide de quelques bouteilles de ce délicieux muscat que j'ai un bras dont je ne puis pas me servir aussi bien que de l'autre. » (Montauban le 10 octobre 1813)
Le petit filleul est le fils de Thérèse, François, alors âgé de 10 ans.
L’oubli teinté d’humour que notre musicien rechercherait dans un verre de muscat, est lié à un fâcheux accident de cheval survenu en juillet qui lui a valu une fracture du bras avec complications.
Quant à la nièce, c’est Thérèse Cabaner, épouse d’Antoine Jaubert, lui-même fils d’Angélique Campagne ; leur fille, Joséphine Jaubert, épousera en 1829 Bruno Magloire de La Fabrègue, ancêtre de M. Pierre-Henri de la Fabrègue, propriétaire-vigneron du Domaine de Rombeau, membre bienfaiteur de l’association « Les Amis de François de Fossa », jusqu’à son décès en juin 2020.
Un fac-simile de la première page de cette lettre fut offert à M. de La Fabrègue le 6 décembre 2016, à l’occasion d’une soirée littéraire et musicale présentée par Nicole Yrle et Juan Francisco Ortiz dans la très belle Salle des Vitraux du Domaine.
Nicole Yrle
L'histoire des recherches sur François de Fossa effectuées par Matanya Ophee.
| Dans ce document, Matanya Ophee nous raconte comment il a trouvé François de Fossa et les recherches qu'il a effecuées afin de nous apporter les éléments de sa vie et de son parcours que nous connaissons aujourd'hui. Ce document au format pdf est en anglais. |
| François de Fossa's researches by Matanya Ophee |
| Ici, Matanya nous pose la question : « Où donc, vers quel insoupçonnable paradis se sont envolées toutes les notes du guitariste ? » Voici, en français et au format pdf ou en vidéo, la retranscription de la conférence qu'a donnée Matanya Ophee en 2015. |
| Transcription écrite de la Conférence de Matanya Ophee sur François de Fossa. |
| Vidéo de la Conférence de Matanya Ophee sur François de Fossa [© Giorgio Menegoni - Artstudio] |
Le parcours de François de Fossa pendant la guerre d’indépendance (1808-1810) .
par
Nicole Yrle (écrivain) et
Michel Yrle (amateur d'Histoire)
le 2 octobre 2018 à Perpignan
Nicole Yrle (écrivain) et
Michel Yrle (amateur d'Histoire)
le 2 octobre 2018 à Perpignan
| Au cours des 19 mois, de juillet 1808 à janvier 1810, où aucune lettre n’est disponible, le parcours de François de Paule de Fossa ne peut faire l’objet que d’une reconstitution approximative à partir de deux documents essentiels : |
| • les états de service militaire fournis par de Fossa en février et septembre 1815 à l’appui de sa demande d’incorporation à l’armée française ; bien que ce document semble couvrir et jalonner – outre ce que l’on sait par ailleurs des épisodes d’Acapulco et Cadiz – l’ensemble de la période de juin 1808 à janvier 1810, il convient de rester très prudent aussi bien vis-à-vis des dates de ses affectations successives que du détail des « affaires » auxquelles il a participé : Agoncillo, Tórtola, Tudela, Almonacid, Ocaña et la Sierra Morena ; • la lettre adressée au négociant franco-espagnol Garcies le 17 juillet 1814, incluse dans celle adressée à Thérèse le 9 août suivant ; il y fait état des « perfides machinations de Buonaparte » qui l’ont conduit à « la première armée que j’ai rencontrée, qui fut celle du général La Cuesta », avec la précision qu’il a toujours eu pour mission d’instruire les recrues et qu’il exerça durant plus d’un an les fonctions de sargento mayor – quelque chose entre capitaine et commandant – au 2e de Jaen jusqu’à sa capture à Grenade fin janvier 1810. |
L’engagement de François de Fossa dans l’armée des insurgés espagnols
| dont on peut trouver une biographie relativement crédible sur Wikipedia, puisqu’on peut la recouper avec d’autres sources – avait déjà été signalé de 1805 à 1807 comme aide de camp du lieutenant général Gonzalo O’Farril (1754-1831), à l’époque où celui-ci était missionné par Napoléon pour assurer la défense du petit royaume d’Etrurie dont la reine Maria Luisa de Bourbon-Parme était la fille du roi d’Espagne Carlos IV. Signalons au passage qu’O’Farril et Zayas sont tous deux nés à La Havane (Cuba) et sont apparentés de plusieurs manières, avec des liens triangulaires entre les familles O’Farril, Zayas et Chacón. Peu après la dissolution du petit royaume, les deux cousins se retrouvent au printemps 1808 à Madrid, où O’Farril est devenu ministre de la Guerre de la Junte de gouvernement à laquelle Ferdinand VII avait délégué ses pouvoirs avant de se faire piéger par Napoléon à Bayonne, tandis qu’Azanza y devenait ministre des Finances et appelait Fossa à ses côtés. Il n’est pas exclu que Zayas ait joué durant quelques semaines auprès d’O’Farril un rôle analogue à celui que jouait Fossa auprès d’Azanza. Fossa et Zayas étaient donc déjà logiquement proches. À partir de là, Zayas se révèle un bon « fil directeur » pour apprécier le parcours de François de Fossa. Pour commencer, Zayas va se trouver mandaté par la Junte pour transmettre un message discret à Ferdinand VII comme quoi les choses ne se passent pas à Madrid comme prévu : Zayas fait ainsi un aller-retour Madrid-Bayonne, remplit sa mission, se fait arrêter en France puis est relâché le 11 mai. Mais dès son retour à Madrid, il reçoit l’ordre de s’embarquer à La Corogne avec un contingent devant rejoindre Buenos-Aires, car l’Argentine aussi s’agite ! Or, sur la route de La Corogne, Zayas va faire étape vers le 1er juin 1808 à… Valladolid au moment précis où poussé par l’effervescence populaire, le vieux général Gregorio Garcia de la Cuesta (67 ans) crée ex nihilo l’éphémère et autoproclamée Armée de la Castille pour lutter contre l’envahisseur français. Zayas sympathise alors avec La Cuesta, qui en fait aussitôt son chef d’état-major. Oubliée l’Argentine. |
François Fossa, le Roussillon et les élites roussillonnaises à la fin du XVIIIe siècle (une esquisse)
par Gilbert LARGUIER
Professeur émérite d’histoire moderne
Université de Perpignan Via Domitia
Professeur émérite d’histoire moderne
Université de Perpignan Via Domitia
| La carrière du juriste François Fossa (1726-1789) est exceptionnelle. |
| Son intérêt prend tout son relief lorsqu’on la replace dans l’histoire du Roussillon, au sein de la séquence originale qui va du traité des Pyrénées (1659) à la veille de la Révolution (1789). |
| Préalablement une mise en perspective est nécessaire. Le Roussillon était en effet profondément différent de ce qu’il est aujourd’hui. |
Le Roussillon entre deux couronnes
| En 1789 la province du Roussillon comptait environ 100 000 habitants, Perpignan 13 000. Ces chiffres sont à comparer avec la situation de la province en 1659, lors du traité des Pyrénées, et avec aujourd’hui. Un recensement donne, pour 1659 : 58 000 habitants, 3 850 pour Perpignan. Actuellement le département des Pyrénées-Orientales compte environ 470 000 habitants et Perpignan 120 000. Ces chiffres peuvent être considérés comme approchés. Ils ne s’éloignent cependant guère de la réalité, donnent des proportions éclairantes : en 1659 la province du Roussillon comptait environ sept fois moins d’habitants qu’aujourd’hui (il faut défalquer au chiffre actuel la population des Fenouillèdes, terres languedociennes intégrées dans le département des Pyrénées-Orientales créé en 1790) ; en 1789, 4,5 fois moins. Le département des Pyrénées-Orientales est en effet un de ceux, en dehors de la région parisienne, dont la population a le plus augmenté au cours de la période contemporaine. Augmentation qui s’est accompagnée d’une profonde transformation de sa répartition : l’intérieur était, relativement, plus peuplé qu’aujourd’hui, la zone côtière au contraire quasiment vide d’habitants. Ainsi, en 1806, il n’y avait entre Argelès et Leucate que 700 habitants (dont 141 à Canet). La Catalogne, dans son ensemble, au milieu du XVIIe siècle, dépassait de peu 500 000 habitants, et Barcelone en comptait environ 50 000. Cet étiage démographique du milieu du XVIIe siècle, imputable à une situation ancienne, était le résultat d’une addition de facteurs :
|